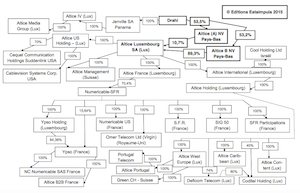source : https://lavamedia.be/fr/venezuela-lepouvantail-agite-par-loccident/
Un autre son de cloche que celui diffusé par les médias dominants.
u Zinu
Venezuela : l’épouvantail agité par l’Occident
![LavaRevue02-redkitten-TRK012cover01-350x490]()
EVA DERONT, Revue Lava, 2 décembre 2017
Entre inflation, perturbation de l’approvisionnement en biens de première nécessité et barricades, le Venezuela est devenu l’épouvantail agité en Europe pour effrayer tous ceux qui pourraient être tentés par une remise en cause du système capitaliste. Jusqu’en juillet 2017, l’opposition vénézuélienne de droite et d’extrême droite a profité des pénuries et de la dégradation de la situation économique pour déclencher une nouvelle vague de violences et tenter de renverser le gouvernement de Nicolás Maduro. Sans complaisance avec les erreurs du gouvernement, Maurice Lemoine, ancien rédacteur en chef du Monde Diplomatique, fait partie des rares journalistes de terrain qui cherchent à donner une vision factuelle des événements, en replaçant le sabotage économique au centre de l’analyse de la situation politique. Un aperçu de l’ampleur de la tâche et des obstacles auxquels peut se confronter tout gouvernement authentiquement de gauche…
Dans cet entretien, Maurice Lemoine analyse les récents développements des crises qui secouent le Venezuela. Il décrit les tentatives de déstabilisation nationale et internationale, ainsi que les réactions de la population et de l’opposition.
Cet entretien, relu et réactualisé par Maurice Lemoine sur notre proposition, a été réalisé à Paris le 13 octobre 2017, deux jours avant les élections des gouverneurs régionaux.
Article repris par venezuelainfos
mardi 5 décembre 2017
dans AGORAVOX
Éva Deront. Entre avril et juillet 2017, le Venezuela a été le théâtre d’affrontements et de violences de la part de militants de droite et d’extrême-droite (attaque à l’hélicoptère contre la cour suprême, jeune afro-descendant brûlé vif, barricades, attaques contre la Garde nationale). Comment caractériser l’extrême droite vénézuélienne par rapport aux groupes que l’on connaît en Europe ?
Maurice Lemoine. À 75 %, les manifestants d’opposition au Venezuela ne sont pas des fascistes. Ils appartiennent à une classe moyenne – classe moyenne « haute » et classe moyenne « basse » – qui, majoritairement, par son mode de vie, s’identifie à la bourgeoisie et aspire à rejoindre cette « élite ». (1)
Une partie de leurs homologues seraient dans la rue, ici aussi, si Mélenchon en France ou le PTB en Belgique arrivaient au pouvoir et commençaient à prendre des mesures sociales considérées comme radicales.
Mais il y a aussi une droite dure et une extrême droite. Ce qui les caractérise ? Leur objectif clairement affiché : renverser par n’importe quel moyen, y compris la violence, le chef de l’État. En France, nous avons eu deux périodes de cohabitation : Balladur avec Mitterrand et Jospin avec Chirac. La première chose qu’ont faite ces Premiers ministres en arrivant à l’Assemblée nationale n’a pas été de dire : « On se donne six mois pour renverser le Président. » Au Venezuela, si.
Dans les manifestations, l’opposition utilise des groupes de choc, une espèce de mélange de nervis, de délinquants et, près de la frontière, dans les États de Miranda et Táchira, de paramilitaires colombiens… Il y a aussi, c’est très intéressant, toute une génération de jeunes petits bourgeois qui vivent leur mai 68 à l’envers. Ils sont comme des fous : il n’y a jamais eu autant de selfies à Caracas ! Ils passent leur temps dans les manifestations et ont réellement l’impression de se battre pour la liberté.
Vous avez passé trois semaines, en juin, dans les manifestations : arrivez-vous à quantifier cette participation ?
Prenons une manifestation d’environ 20 000 personnes : il y en a environ 15 000 de la classe moyenne — « On n’est pas content, on en a marre du castro-communisme ! » —, dont 3000 jeunes, qui vivent l’aventure de leur vie, et puis les violents, nervis et lumpen. Ce sont eux qui vont défier la Garde nationale.
L’opposition utilise des groupes de choc, une espèce de mélange de nervis, de délinquants et de paramilitaires colombiens
Un universitaire de gauche – on dénonce beaucoup les mensonges ou l’incompétence des journalistes, mais il faudrait aussi s’intéresser à ce que racontent les universitaires – a décrit les manifestations de la façon suivante : les gens manifestent, la Garde nationale réprime, et les jeunes s’interposent pour protéger… C’est un mensonge éhonté ! Je les ai vus faire : les gens manifestent, les groupes de choc prennent la tête de la manifestation, vont défier la Garde nationale, et… les gentils petits bourgeois et le reste sont derrière. Et à un moment, c’est l’affrontement entre groupes.
Quelle est alors la réaction des forces de l’ordre ?
L’encagement d’une manifestation comme on a pu le voir en France lors des mobilisations contre la loi El-Kohmri, ça n’existe pas. Paradoxalement, la police est beaucoup plus provocatrice et répressive en France qu’elle ne l’est au Venezuela. Là-bas, ce n’est pas compliqué, des groupes bloquent la autopista [autoroute urbaine, NDLR] qui joint l’Est et l’Ouest de Caracas. Tous les jours ils viennent là, s’installent, provoquent la Garde nationale ; et puis au bout de deux heures, la Garde nationale vient dégager la voie avec des canons à eau et des lacrymogènes. Ce n’est pas agréable, mais les méthodes sont moins perverses qu’ici.
Tout ce qui se passe au Venezuela en ce moment – que ce soit la violence, les pénuries, les difficultés – n’est pas destiné aux Vénézuéliens, mais à la communauté internationale.
En tant que journaliste, je n’ai pas eu de problème avec les forces de l’ordre. À un moment, j’étais tout seul avec mes deux appareils photo, tout le monde était parti en cavalant ; la Garde nationale arrive, s’arrête et repart. Je n’ai pas vu les journalistes se faire matraquer. En revanche, je ne me sentais pas particulièrement en sécurité au milieu des groupes de délinquants.
Depuis l’élection de l’Assemblée constituante le 30 juillet 2017, on assiste à une scission au sein de l’opposition, affaiblie. Les violences ont cessé. Ces groupes de choc aujourd’hui, que font-ils ? Et que prévoit la droite suite aux élections régionales du 15 octobre ?
Je ne sais pas quelle est leur stratégie. L’élection aux régionales s’est déroulée dans des conditions normales puisque l’opposition avait décidé d’y participer. Comme toujours, on a assisté dans un premier temps à l’application de leur logique « pile je gagne, face tu perds ». Donc là où ils ont gagné, cinq États, ils ont dit : « on a gagné ». Mais là où les chavistes l’ont emporté, dans dix-huit États, l’opposition a crié : « il y a fraude ! ». Évidemment, on oublie ensuite que les représentants de tous les partis avaient participé aux essais techniques du système électoral et qu’ils avaient tous donné leur aval.
Aujourd’hui, alors que quatre des cinq gouverneurs élus de l’opposition ont reconnu l’Assemblée constituante, il y a deux problèmes pour l’opposition : leur base est complètement désarçonnée et ils ne savent plus où ils en sont. Ils ont envoyé leurs forces dans la rue pendant quatre mois en leur disant : « on renverse Maduro, c’est une dictature » ; ils ont accusé le Conseil national électoral de tous les maux et, d’un seul coup, ils leur annoncent : « On arrête tout et on participe aux élections. » Les radicaux vouent les dirigeants aux gémonies, les autres se demandent à quoi ça rime. Et par ailleurs, ils ont organisé des primaires pendant lesquelles ils se sont mutuellement lynchés. Maria Corina Machado, la seule qui ne voulait pas participer aux élections, a par exemple lancé son nouveau parti Soy Venezuela. Et celui qui a tiré son épingle du jeu, c’est le vieux parti social démocrate Accion Democratica, qui est resté un peu en retrait pendant les violences.
Quant à la suite des événements, elle est aussi incohérente : mettant en cause le Conseil National Electoral, une partie de la MUD [Table de l’unité démocratique, coalition anti-chaviste – NDLR] décide qu’elle ne participera pas aux élections municipales de décembre, tout en annonçant qu’elle se prépare pour la présidentielle de 2018…
Qu’est ce qui fait qu’on a eu et qu’on a encore cette attaque de la droite nationale et internationale sur le Venezuela, à l’instar d’Emmanuel Macron dénonçant « une dictature qui tente de survivre au prix d’une immense détresse humaine » ? (2)
La première raison, un grand classique, ce sont les ressources : pas seulement en pétrole [le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole au monde, NDLR (3) ], mais également en eau, en or, en minerais en tous genres. En témoigne le grand projet de mise en exploitation de l’Arco minero, l’Arc minier, une zone riche en ressources minérales, or, fer, coltan, qui représente environ 10 % du territoire vénézuélien. La deuxième chose, c’est que, du fait de l’action de Chávez, et de son aura, même après son décès, le Venezuela est devenu un symbole. Faire tomber Maduro, c’est faire tomber le chavisme. Qu’on aime ou pas Maduro, si on prend les choses raisonnablement, des élections présidentielles auront lieu en 2018. Mais ce que l’opposition veut, c’est pouvoir proclamer à la face du monde : « Une révolte populaire a fait tomber le chavisme ! » Cela neutraliserait pour les vingt prochaines années l’espoir et la dynamique que la révolution bolivarienne a soulevés dans toute la région. Donc il faut que Maduro tombe.
Il y a des problèmes sérieux au Venezuela, y compris une gestion pas toujours optimale du gouvernement, mais la guerre économique et la déstabilisation démultiplient les difficultés
Les fameuses pénuries… Elles ne sont pas dues à la gestion de Maduro. Comme par hasard, il y en a eu systématiquement avant toutes les élections : l’ensemble de la production de Polar [une des principales entreprises alimentaires, NDLR] a reculé de respectivement 37 %, 34 % et 40 % avant l’élection présidentielle de 2013, pendant la phase de violence de 2014 – la Salida – et avant les législatives de décembre 2015. Battu, Capriles, candidat de l’opposition aux dernières élections présidentielles, avait déclaré après l’élection de 2012 : « Chávez, c’est le Cassius Clay de la politique. » Donc, après sa mort, quand ils ont vu Maduro arriver, ils se sont dit : « Lui, on va lui régler son compte ! » Et les pénuries se sont aggravées. À l’époque du blocus pétrolier fin 2002-début 2003, tout le monde a admiré Chávez, car il a tenu pendant deux mois face à la guerre économique ; paradoxalement, bien peu se rendent compte de la capacité de résistance de Maduro : cela fait trois ans qu’il résiste !
Quant au traitement médiatique et à la récupération politique de la « famine » : Je suis revenu avec cinq cents photos de la rue, des manifestations des chavistes et de l’opposition… Tous les gens m’ont dit : « Il a fallu qu’on change d’habitudes alimentaires, j’ai perdu deux kilos. » Voilà. Mais le traitement qui en est fait, c’est comme si vous regardiez les gens dans la rue, ici, et que vous me disiez qu’ils ont l’air famélique… Ça ne tient pas debout.
Que ce soit Jean-Luc Mélenchon en France ou Pablo Iglesias en Espagne, la gauche européenne est constamment attaquée lorsqu’elle évoque le Venezuela. Quels sont les enjeux de la situation ?
Il ne se passe pas un jour où l’on ne tape pas sur le Venezuela dans les médias français ; mais 300 000 morts au Congo et… rien. Pourquoi cette différence ? C’est clairement un enjeu de politique intérieure. La cible en France, c’est la France insoumise ; en Grande-Bretagne, Corbyn ; en Espagne, Podemos ; en Allemagne, Die Linke. Le discours est simple : « si vous votez Mélenchon, vous serez dans la même situation que le Venezuela. »
Tout ce qui se passe au Venezuela en ce moment – que ce soit la violence, les pénuries, les difficultés – n’est pas destiné aux Vénézuéliens, mais à la communauté internationale. La violence sert à faire apparaître le gouvernement de Maduro comme répressif. Pourtant, Maduro prône régulièrement le dialogue, pour montrer à cette communauté internationale qu’il est prêt à discuter. Il y a peu, il a accepté que le Mexique et le Chili, qui ne sont pas des amis du Venezuela, fassent partie des médiateurs internationaux. Si les observateurs et la communauté internationale étaient de bonne foi, ils ne pourraient que constater qu’il y met de la bonne volonté et que c’est l’opposition qui bloque.
N’est-ce pas naïf ? L’opposition a constamment répété qu’elle ne voulait pas de dialogue et qu’elle souhaitait renverser le gouvernement. (4)
Elle est plus perverse que ça. Une partie d’entre elle passe son temps à dialoguer tout en annonçant à ses partisans qu’il n’est pas question de dialoguer. Et de fait, elle rompt régulièrement les conversations en mettant en cause le pouvoir. Double bénéfice : d’un côté, elle paraît modérée, rapport à la communauté internationale ; de l’autre, elle laisse les radicaux mener la déstabilisation. Et Maduro apparaît comme « le méchant », alors qu’il accepte la médiation du Mexique, du Chili et de Zapatero, qui n’a rien d’un gauchiste…
Pour comprendre la situation économique qui perturbe grandement la vie des Vénézuéliens aujourd’hui, pourriez-vous revenir sur le partage des tâches entre l’État et le secteur privé qui représente toujours plus de 90 % des entités industrielles ? A-t-on une idée de l’absence d’investissement dans les domaines clefs tels que l’énergie, l’agroalimentaire ?
La légende veut que le Venezuela soit un pays pétrolier qui n’a jamais pensé à diversifier son économie. Si l’on admet qu’il n’a pas réussi à s’extraire de cette dépendance pour l’exportation – 90 % des devises du pays proviennent de l’exportation du pétrole par le secteur public –, cela ne veut pas pour autant dire que rien d’autre n’existe à l’intérieur du pays : 84 % de la production nationale ne provient pas du pétrole, mais de la manufacture, des services, du commerce et de l’agriculture (5) ; ce n’est néanmoins pas suffisant pour en faire un pays industriel.
Parmi les économistes qui arrivent au constat qu’il n’y a pas eu de diversification, aucun ne propose de solution. Or, en regardant à l’international, quels sont les pays qui ont pu changer leur mode de développement ? Les tigres asiatiques dans les années 1990. Qu’ont-ils utilisé ? Leur avantage comparatif : l’exploitation de la main d’œuvre dont le coût a été réduit au minimum. De même pour les maquiladoras mexicaines, les usines de sous-traitance. Par définition, ce n’est pas l’optique des gouvernements de gauche d’Amérique latine.
Dans un article paru dans sur le site Mémoire des luttes, vous établissez un parallèle entre cette déstabilisation et la guerre économique qui a visé Salvador Allende, au Chili, au début des années 70. Quels en sont les principaux axes ?
Il y en a quatre : des pénuries organisées, une inflation artificiellement provoquée, un embargo commercial et un blocus financier international. Pour importer les biens de première nécessité, l’État fournit des dollars à taux préférentiel au secteur privé. En 2004, les montants atteignaient 15 milliards de dollars et il n’y avait aucune pénurie. En 2013, on arrivait à 31 milliards et tous les biens de première nécessité avaient disparu. On parle souvent du papier toilette : d’où vient la pénurie, alors que l’entreprise qui importe et distribue les rouleaux, Kimberley Clark, a reçu 1000 % de devises en plus en 2014 qu’en 2004 et 2011 ?
Des sommes monstrueuses, allouées à l’importation des aliments ou des médicaments, ont été détournées par le secteur privé
Depuis 2003, un contrôle des changes a été instauré pour éviter la fuite des capitaux. Dans tous les pays où l’on a agi de même, on a assisté au développement d’un marché parallèle. La particularité du Venezuela, et là on est dans la guerre économique, c’est que ce marché parallèle échappe à toute logique économique. Le taux de change est manipulé par le site DolarToday, depuis la Colombie et Miami. (6)
Le dollar parallèle peut atteindre 10 000 bolivars pour un dollar, voire 42 000 bolivars actuellement [60 000 à la mi-novembre, NDLR] : cela n’a aucune rationalité, mais entraîne, évidemment, des conséquences désastreuses sur l’inflation et le niveau de vie.
Un autre instrument de la déstabilisation économique, c’est la contrebande vers la Colombie. Par exemple, des médicaments achetés avec les dollars préférentiels arrivent au Venezuela, où ils ne sont pas mis en vente : ils repartent directement vers la Colombie, souvent avec la complicité de militaires et de gardes nationaux achetés par les mafias. Des tonnes de médicaments. Et, quinze jours après, ils reviennent au Venezuela où ils sont revendus dix fois plus cher au marché noir.
Autre exemple : en 2004, les entreprises pharmaceutiques ont reçu environ 600 millions de dollars pour acheter des produits à l’extérieur et les revendre en bolivars au Système public national de santé. Il n’y avait alors pas de pénurie. En 2013 et 2014, on ne trouve plus de médicaments et pourtant les entreprises ont obtenu entre 2 et 3 milliards de dollars… Sur place, j’ai demandé : « Pourquoi ne nationalisez-vous pas et pourquoi l’État n’importe-t-il pas lui-même les médicaments ? » On m’a répondu, ce qui demande à être vérifié : « Les laboratoires internationaux ne vendront pas directement à l’État vénézuélien car ce serait se mettre à dos toute la corporation ». Ces problèmes, relativement récents dans ce domaine, amènent à poser la question : « Doit-on et peut-on court-circuiter les laboratoires pharmaceutiques occidentaux ? » Un début de solution a peut-être été trouvé. En septembre dernier, le Venezuela a signé un accord avec l’Inde pour y acquérir une partie de ses médicaments.
En réponse à cette situation, observez-vous une évolution dans les mesures économiques prises par l’État ?
On ne discerne pas de boussole économique ou idéologique évidente. Face aux problèmes, faut-il envisager des nationalisations ? Je prends l’exemple du pain : historiquement, le Venezuela ne produit pas de blé, c’est l’État qui l’importe. Il le fournit à des minoteries privées qui transforment le blé en farine, mais, ensuite, un véritable chaos affecte la distribution. La majorité des boulangeries du pays n’est pas livrée régulièrement tandis que d’autres, plus favorisées, leur revendent au prix fort une partie de leurs surplus, ou préfèrent vendre des gâteaux, des brioches, des sandwiches… plutôt que du pain. J’ai posé la question à un ancien ministre de l’économie, Luis Salas : puisqu’il y a sabotage, pourquoi ne nationalisez-vous pas ? Il répond — et comment lui donner tort ? —: « l’État ne peut pas se charger de tout et n’a pas la compétence pour faire du pain et distribuer du pain ». Ça peut toute fois se discuter, compte tenu de la présence d’oligopoles : 50 % de la production totale d’aliments traités par l’agro-industrie sont concentrés dans 10 % du total d’entreprises privées. (7)
Cela a pourtant été fait en partie pour le pétrole : alors que, avant son arrivée, l’état-major de PDVSA prenait le chemin de la privatisation, Chávez a fait en sorte que l’État devienne l’actionnaire majoritaire de toutes les concessions du Venezuela, et reprenne le contrôle des activités d’exploration, de production et des services annexes…
Oui. D’ailleurs Salas me parle du pain, puis il s’arrête et réfléchit : « Tout de même… Si nous sommes capables de faire du pétrole, nous devons être capables de faire du pain…» Et il ajoute : « Ce qu’il faut, ce n’est pas nationaliser, mais créer des entreprises alternatives avec la base. » De fait, on connaît les problèmes induits par des nationalisations systématiques : on crée à terme une bureaucratie, avec ses contraintes et inconvénients.
L’établissement d’une bureaucratie n’est pas automatique : la base chaviste a souvent demandé à avoir plus de contrôle sur l’appareil d’État.
Oui, mais se pose le problème de la ressource humaine. Dès sa naissance, la révolution bolivarienne a manqué de cadres, qui sont très souvent liés à l’opposition. Le meilleur exemple en est la réforme agraire. Elle a été faite et elle a eu des succès : de 2001 à 2010, la production agricole a augmenté de 44 % ; 7 millions d’hectares ont été régularisés, les paysans obtenant des titres de propriété ; 3,5 millions d’hectares ont été repris au latifundio et 1 million de nouveaux hectares ont été mis en production, même si cette augmentation de la production a été contrebalancée par une augmentation de la consommation. Du début de la réforme agraire en 2001 à la fin 2004, par exemple, près de 7 000 coopératives ont été créées. Elles ont dramatiquement manqué de cadres. Il reste 2 % de paysannerie au Venezuela, sans les cadres techniques nécessaires pour relancer une agriculture moderne, écologique, etc. Les paysans se sont souvent retrouvés livrés à eux-mêmes, ils ont beaucoup de mal à moderniser ce secteur. C’est ce manque d’efficacité et d’efficience qui fait apparaître la réforme agraire comme un semi-échec, alors que c’est globalement une réussite.
Ensuite, l’appareil d’État n’est pas constitué que de militants : vous avez le ministre, cinq vice-ministres, vingt cadres engagés, qui veulent que les choses avancent et puis, derrière, une pesanteur terrible de ceux qui sont là, qui ne sont pas forcément chavistes, et qui soit sabotent, soit ne font pas grand-chose.
Les licenciements de ceux qui voulaient forcer Chávez à la démission, après les lock-outs patronaux de 2002-03, n’ont eu lieu que dans le secteur pétrolier ?
Oui, 18 000 personnes en tout. En même temps c’est difficile : vous vous mettez dans la position de vous faire accuser de totalitarisme, d’État policier… Et il faut savoir composer avec les réactions de la « communauté internationale ». La base chaviste, elle, elle réclame la mano dura, une « main ferme ».
El bachaqueo, le marché noir qui s’est établi suite au détournement et à l’accaparement des biens de première nécessité n’existerait pas si on se trouvait dans un État policier. Les Cubains, par exemple, ont instauré une sorte de contrôle social à travers les comités de défense de la révolution, les CDR, dans tous les quartiers. Et vous n’avez pas ce phénomène de corruption.
Des sommes monstrueuses, allouées à l’importation des aliments ou des médicaments, ont été détournées par le secteur privé. Le reproche que l’on peut faire à l’État n’est pas de ne pas avoir investi, mais de ne pas avoir assez contrôlé. En ce moment, après l’élection de la Constituante et l’éviction de la procureure générale Luisa Ortega, ils sont en train de reprendre en mains le Ministère public et de découvrir d’énormes affaires de corruption, des surfacturations de l’ordre de 200 millions de dollars ! Par ailleurs, une cinquantaine de cadres dirigeants de PDVSA ont été arrêtés. Pour la première fois, ils s’en prennent sérieusement à la corruption.
Pourquoi ce problème de corruption n’a t-il pas été traité avant ?
La dette sociale était tellement énorme, quand Chávez est arrivé au pouvoir, qu’il a dit : « Il faut sortir les gens de la pauvreté, il faut qu’ils mangent. » Comme il y avait de l’argent, ils ont dépensé sans compter, sans trop se préoccuper de la corruption. Ça a été peut-être une certaine naïveté de gauche. C’est uniquement lorsque les ressources ont sérieusement diminué, du fait de l’effondrement des prix du pétrole, que le problème s’est posé. On a découvert tout récemment que c’est précisément au cœur du Ministère public que la corruption a pu se développer ; apparemment, sous l’autorité de la procureure générale Luisa Ortega, il s’était transformé en une entreprise de chantage. Des magistrats disaient aux gens qui trempaient dans des affaires de corruption : « Soit tu paies, soit on te poursuit. » Cela faisait longtemps que la base chaviste dénonçait la grande corruption : elle est bien consciente du train de vie de certains bureaucrates.
C’est également ce qui alimente les critiques concernant la « bolibourgeoisie »… Est-ce qu’on a effectivement assisté à la naissance d’une nouvelle bourgeoisie ? Comment se caractérise-t-elle ?
Il y a évidemment des chavistes ou des pseudos chavistes corrompus. Après sa tentative de coup d’État en février 1992, Chávez a passé deux ans en prison, puis il a été amnistié pour faire baisser la pression due à une profonde crise sociale et à sa forte popularité. Beaucoup se sont rendus compte que Chávez, c’était l’avenir. À son arrivée au pouvoir en 1999, il a donc eu autour de lui des révolutionnaires sincères, mais aussi un certain nombre d’arrivistes qui comprennent que c’est « l’endroit où il faut être ». Ensuite, il y en a qui se bâtissent des fortunes à l’ombre du pouvoir : soit par la corruption, soit par des voies classiques de formation de la bourgeoisie. On a connu ce phénomène au Nicaragua ou dans tous les pays qui, un jour, ont fait une révolution ou se sont délivrés du joug colonial… Mais les grandes affaires de corruption impliquent des fonctionnaires et des gens du secteur privé. Par exemple, la majorité des entreprises qui trafiquent les aliments et les biens de première nécessité appartiennent au secteur privé.
Chávez avait beaucoup évolué. Il était plutôt « troisième voie » avant de se radicaliser suite au refus de la droite d’accepter quelque réforme que ce soit
Il faut préciser que ces seuls phénomènes n’expliquent pas la crise. Le Brésil connaît également des problèmes de corruption, cela n’en fait pas pour autant un pays à genoux. Il y a des problèmes sérieux au Venezuela, y compris une gestion pas toujours optimale du gouvernement, mais la guerre économique et la déstabilisation démultiplient les difficultés. Les erreurs du pouvoir, elles, y contribuent à hauteur de 20 % — 30 %.
Face à cette situation, on s’interroge sur le soutien actuel de la population vénézuélienne. Les élections législatives de 2015, qui ont vu la droite emporter 99 sur 167 sièges au Parlement, ont marqué un moment de lassitude et de désapprobation de la base chaviste envers la politique menée par Maduro. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Le cœur dur du chavisme on l’estime à 30 % de la population. L’événement important a été l’élection de l’Assemblée constituante en juillet 2017 : le cœur chaviste a réagi puisque plus de huit millions de personnes sont allées voter, soit 41 % du corps électoral, malgré les barrages physiques et les menaces de l’opposition. Ça, c’est un vrai signe, qui a eu des conséquences totalement inattendues puisque la violence s’est arrêtée du jour au lendemain. De même, lors des régionales du 15 octobre, on a assisté à la victoire du chavisme dans dix-huit États sur vingt-trois : il s’impose avec 54 % des suffrages et une participation de 61,4 %, alors qu’il s’agit d’un scrutin pour lequel les Vénézuéliens, traditionnellement, se mobilisent assez peu.
La guerre économique affecte les gens d’une manière extrêmement dure. Ils galèrent pour trouver à manger, payent plus cher à cause du marché noir, leur pouvoir d’achat s’effondre. Et donc à un moment ils ont dit : « Maduro, qu’est-ce que tu fais ? » Ça a été le vote rejet de 2015, de découragement, de fatigue, mais qui ne s’est pas traduit par un transfert des votes chavistes vers la droite : celle-ci a gagné 350 000 voix, les Chavistes en ont perdu deux millions.
Ont suivi les « guarimbas » de 2014 [violentes barricades de rue qui ont causé plusieurs morts, NDLR] et la violence de cette année-ci, entre avril et juillet. Les gens se rendent compte de qui est responsable de cet état de fait. Dans la rue, dans le quartier de Chacaito, j’ai vu des gens exaspérés qui en avaient marre des manifestations de l’opposition et qui encourageaient les policiers. Même une partie des sympathisants de l’opposition a été prise en otage par ces manifestations. Chacao, Chacaito, Altamira, c’est un peu l’équivalent de Neuilly, Auteuil, Passy à Paris. Là-dessus j’ai des témoignages directs : des groupes d’extrême droite étaient présents dans les quartiers, en permanence, et les gens ne pouvaient plus emmener leurs enfants à l’école. À chaque fois qu’ils passaient, c’était : « on défend la liberté : tu paies ». Et donc y compris des membres de l’opposition plutôt modérée, plutôt respectable, en ont eu marre.
Vous avez préfacé le livre « Des Taupes à Caracas », qui raconte la vie et la participation à la révolution bolivarienne de l’ensemble de la population vénézuélienne : des médias locaux, des aides soignants, des paysans, des policiers… Dans le processus de contre-révolution en cours, comment se positionnent les comités populaires, les coopératives, et les structures de démocratie directe qui avaient été mises en place par Chávez ?
Il y a des secteurs plus radicaux, d’autres moins. Tout en se montrant critique à l’égard du gouvernement, de la bureaucratie et de leurs dysfonctionnements, le noyau dur du chavisme demeure d’une fidélité absolue à Maduro.
Au niveau des conseils communaux, depuis Chávez, l’une des difficultés est l’antagonisme fréquent entre les conseils et les maires ou les députés. Vous êtes élu maire, vous appartenez au PSUV [Parti socialiste Unifié du Venezuela, créé en 2007 par Chávez, NDLR]. De l’autre côté, il y a le conseil communal. Et d’un seul coup, il a des prérogatives aussi importantes que les vôtres, ça n’est pas forcément de votre goût !
Lors de l’élection de l’Assemblée nationale constituante, cette participation populaire a été favorisée par l’élection des 173 représentants sectoriels [sur les 545 membres de l’Assemblée constituante, 364 représentent les circonscriptions municipales, 173 différents groupes sociaux (travailleurs, étudiants, retraités…), et 8 les communautés indigènes, NLDR] : une évolution douce vers le « socialisme du XXIe siècle » de Chávez avec les communes, les conseils communaux…
On retrouve ces relations parfois difficiles au niveau de la paysannerie, lorsque des paysans occupent les terres dues par la réforme agraire et rencontrent l’opposition de gouverneurs, y compris chavistes. Dans le chavisme, il y a de tout : des opportunistes, des gens qui ont passé des alliances avec les grands propriétaires du coin, des paysans qui sont réprimés par la Garde nationale… Aujourd’hui, pour la réforme agraire, c’est la base radicale qui avance, parfois contre la bureaucratie des couches intermédiaires du chavisme ou du pseudo chavisme. Et en général, c’est la paysannerie qui reste la plus fidèle au chavisme, de même que les campagnes. Ce n’est pas un hasard si le système mis en place pour l’élection de la Constituante qui, d’une certaine manière, favorise les campagnes au détriment des villes, fait enrager l’opposition.
Dans certaines régions, notamment à Zulia, Barinas, Apure, les habitants ont créé, avec succès, des brigades de défense populaire pour lutter contre les incendies, le vandalisme et les violences des groupes de droite. Est-ce que ce sont des régions avec une forte composante paysanne ?
Oui, bien sûr. Mais les paysans subissent une grosse pression : au Táchira, par exemple, ils doivent faire face à des groupes mi paramilitaires mi délinquants. La mission brésilienne du Mouvement des sans terre qui est là-bas a été attaquée par des paramilitaires. Plus de cent militants paysans, chavistes, ont été assassinés au Venezuela. Les conflits sont permanents.
Assiste-t-on à la création d’une classe moyenne qui se désintéresserait du processus après avoir profité du programme Sembrar el petroleo (semer le pétrole) ?
C’est une thèse qui a été développée en Équateur surtout : les gens sortent de la pauvreté, ils accèdent à la classe moyenne et à partir de là, aspirent à continuer en s’identifiant aux plus riches. C’est en partie vrai, en partie seulement.
Il y a eu des phénomènes comme ce qu’il s’est passé avec la Mision Vivienda : l’octroi de 1,8 millions de logements sociaux puis la découverte que des gens qui y avaient eu accès les avaient revendus. Mais on ne peut pas tout expliquer par ça.
Quand on a connu le Venezuela avant Chávez, la différence saute immédiatement aux yeux. Ce n’est pas un hasard si la base chaviste se remobilise en ce moment
Au niveau du Conseil communal — au-delà du « c’est génial, c’est le processus de Chávez qui est en train de se mettre en place » — une expérience m’a beaucoup éclairé : en allant en visiter un dans la banlieue de Caracas, comme j’étais là pour Le Monde diplomatique qui a plutôt bonne réputation au Venezuela, je m’attendais à rencontrer du monde. J’arrive dans un grand hangar avec… huit personnes. Ils m’expliquent : « Au début on était nombreux, une bonne cinquantaine. Quand les gens se sont rendus compte qu’ils n’allaient en tirer aucun avantage matériel personnel, mais que c’était un travail de militants, ils sont partis. »
Vous avez pourtant signalé que la base s’est massivement mobilisée pour l’élection de l’Assemblée constituante. Est-ce que la Constituante vient répondre à sa demande de « mano dura » et va lui permettre de reprendre de la place dans le jeu politique ?
Oui. J’ai mis un petit bémol sur les conseils communaux, où, partant d’une idée magnifique, on se trouve confronté à une réalité plus complexe.
Mais ce qui va réactiver la base en réalité, c’est la résolution des problèmes économiques quotidiens. Il y a eu un certain scepticisme au moment où Maduro a annoncé l’élection d’une Constituante. Des gens proches se sont demandé : « A quoi ça va servir ? Notre problème c’est qu’on ne trouve ni pâtes ni riz dans les magasins… » Malgré tout, le processus a pris. Il y a des résultats : par exemple, des communes demandent à être entendues, elles ont leurs représentants élus sectoriellement ; les femmes poussent le thème de l’avortement…
C’est le grand brainstorming. Moi aussi j’ai été étonné, surpris, sceptique dans un premier temps. À quoi ça va servir ? La violence a cessé du jour au lendemain. Je ne sais même pas pourquoi, je ne comprends pas la stratégie de l’opposition. Puis vient la destitution de la procureure générale et, d’un seul coup, on s’attaque à la corruption. Face à cette fameuse guerre économique et à une nécessaire réactivation de l’économie, s’ils réussissent à remettre de l’ordre dans la distribution des aliments, des biens, etc. — car leur importation n’a cessé que partiellement — là, pour le coup, ils toucheront l’essentiel.
Qui compose la Constituante ? A-t-elle été principalement nourrie par les rangs du PSUV ?
La partie sectorielle des élus de cette Constituante a soulevé des critiques féroces. Cela mériterait pourtant un vrai débat, notamment chez ceux qui ne cessent de dénoncer la reproduction des élites : là, il y a une représentation des travailleurs, des paysans, des pêcheurs, des étudiants… Ça échappe partiellement à l’appareil du PSUV, ce ne sont pas des leaders traditionnels qui ont été élus.
Vous insistez sur le rôle de la manipulation extérieure pour créer de l’inflation et une situation de chaos économique ; il est difficile à un gouvernement de lutter contre… Mais est-il prévu que la Constituante apporte une réponse économique aux problèmes internes tels que le boycott du secteur privé et de son contrôle des moyens de production et de distribution ?
Dans le cadre de cette Constituante, le pouvoir vient d’annoncer la mise en place spécifique d’une « Constituante économique » chargée de s’organiser à deux niveaux : le premier, structurel, visant le long terme, et chargé de réformer le système économico-productif, de renforcer le système financier et de développer un nouveau système de distribution, de commercialisation et de fixation des prix ; le second, chargé de faire des propositions pour le court terme afin de réactiver la production et de corriger les distorsions structurelles de la fixation des prix. Maduro a souhaité que la base soit impliquée dans ces processus qui ne doivent en aucun cas être bureaucratiques. On verra ce qu’il en sera, sachant que la Constituante s’est donnée deux ans et qu’il y a là des problèmes qu’il faudrait régler très rapidement.
Depuis l’intensification des attaques de la droite, constate-t-on des défections, des bouleversements au sein du gouvernement ?
Non. C’est un phénomène journalistique intéressant : comme tout le monde a envie de prendre ses distances avec le Venezuela, une certaine gauche se rabat sur le « chavisme critique ». Mais seuls cinq des anciens ministres de Chávez ou de Maduro font partie de la « Plateforme du peuple en lutte et du chavisme critique » récemment créée, qui n’a aucun ancrage populaire. Curieusement, on ne médiatise pas les 137 autres ex-ministres qui, à des degrés divers, appuient toujours Maduro.
Mes confrères dénoncent systématiquement la paille dans l’œil de Maduro tout en ignorant la poutre dans celui de l’opposition.
Si l’on prend Jorge Giordani, qui a été l’architecte de la politique économique de Chávez, il a été sorti du gouvernement par Maduro, ce qui a, à l’évidence, engendré une certaine frustration. Mais, tout en dénonçant avec virulence l’actuel gouvernement, il ne procède à aucune autocritique. Affirmer : « en 2012, vingt-cinq milliards de dollars ont été dilapidés dans l’obtention de devises » alors qu’il était lui-même au gouvernement et menait la politique économique… il ne faut quand même pas exagérer ! Tout comme Luisa Ortega : elle était au Ministère public depuis 2007. En trois semaines, elle déclare le contraire de tout ce qu’elle a dit depuis dix ans. Critique, sans aucun doute, mais chaviste sûrement plus : la voici maintenant, cul et chemise avec Washington, réclamant le déferrement de Maduro devant la Cour pénale internationale pour « crimes contre l’Humanité ».
Bien sûr, devant la violence de l’agression, un phénomène logique se produit. Ceux qui défendent la révolution évitent l’étalage des divergences et des critiques. Mais les chavistes sont tous critiques, à commencer par Chávez, qui, un peu avant sa mort, parlait d’un nécessaire golpe de timón, un coup de gouvernail pour rectifier les erreurs voire les dérives de la révolution.
Vous disiez qu’il n’y a pas d’orientation politique ou idéologique aujourd’hui ; pourtant, sur la fin sa vie, Chávez a essayé de revenir à une doctrine plus marquée, le socialisme du XXIe siècle.
Très clairement, avec Chávez puis Maduro, on se trouve dans une séquence post-néolibérale. Mais il est vrai que, à partir de 1998, Chávez avait beaucoup évolué. Il était plutôt « troisième voie » avant de se radicaliser suite au refus de la droite d’accepter quelque réforme que ce soit. Le procès qui est fait à Maduro de rompre avec le chavisme ou de trahir le chavisme n’est pas sérieux. Il prend le relais et poursuit ce que préconisait Chávez, par exemple la mise en exploitation de l’Arco minero. Une étape vers la diversification, même si l’on reste dans une économie de rente. Cette annonce a déclenché de fortes polémiques, curieusement pas tellement à droite, mais à l’extrême gauche. C’est la même chose en Équateur, sur le thème de l’extractivisme : l’extrême gauche s’est déchaînée contre Correa.
Au Venezuela, ce courant présenté comme du « chavisme critique » compte avec Marea Socialista – une des multiples factions trotskystes –, dont le principal leader Nicmer Evans n’a rien trouvé de mieux, il y a quelques semaines, que d’aller participer à un colloque avec la droite et l’extrême droite.
Comment percevez-vous l’attitude de Marea Socialista, aujourd’hui, dans une période de très fortes tensions, de mise en danger du gouvernement ? Les critiques qui sont portées concernant la nature bourgeoise de l’État chaviste, de bonapartisme…
Au nom d’une « révolution parfaite » qui n’existe que dans l’imagination de ceux qui n’ont pas les mains dans le cambouis, la critique systématique permet de se donner le beau rôle à peu de frais. Dès que Chávez est arrivé au pouvoir, la gauche s’est cassée en deux : le MAS, Causa Radical, le PC… Mais que ce soit Marea Socialista au Venezuela, les rénovateurs sandinistes au Nicaragua, l’extrême gauche équatorienne, aucun n’a jamais réussi à représenter une option politique susceptible d’entraîner l’électorat.
Ce qu’ont fait Chávez et Maduro n’est pas parfait. On peut et on doit évidemment avoir un regard critique. En 1973 au Chili, des débats enflammés genre « critique de gauche » de Salvador Allende se déroulaient entre le Parti socialiste, le PC et le MIR. Néanmoins, aussi bien là-bas qu’ici, on avait la lucidité de dire : « Compte tenu de l’agression dont il est victime, la priorité c’est de défendre ce gouvernement socialiste. » Maintenant on découpe l’histoire en tranches : tous les trois ans, on oublie ce qui s’est passé auparavant. Quand on a connu le Venezuela avant Chávez, la différence saute immédiatement aux yeux. Ce n’est pas un hasard si la base chaviste se remobilise en ce moment. Devant la menace d’un retour de la droite, elle, elle se souvient.
Plus personnellement, en tant que journaliste, pourquoi portez-vous cet intérêt à l’Amérique latine et au Venezuela ?
J’ai connu l’Amérique latine dans les années 70-80-90, à une époque où la pauvreté est passée de 120 millions à 225 millions de personnes. Je suis capable de faire la différence. J’appartiens à une génération qui a connu la dictature au Chili, en Argentine, en Bolivie. Quand on me parle de dictature au Venezuela, où il y a des élections avec une opposition organisée et qui domine les médias, ça me fait rire. Au prétexte qu’il y a une crise en ce moment, on oublie tout ce qui a été fait. Or tout ça n’a pas disparu. Entre le Venezuela des années 1990 et d’aujourd’hui, indépendamment de la crise, il y a une grosse différence : l’éradication de l’analphabétisme, le renforcement des structures de démocratie locale, la construction d’ 1 800 000 logements en cinq ans, de 8 000 établissements de santé en seize ans, l’augmentation de 27 % de l’accès à l’éducation secondaire…
Ce n’est pas un hasard si l’offensive est aussi féroce. À l’époque, ils ont renversé Allende car ils étaient inquiets de la contagion pour l’Amérique latine mais aussi pour la France (avec l’Union de la gauche) et l’Italie. En ce qui concerne le chavisme, c’est pareil : pour casser son influence continentale, il faut en terminer avec lui.
La couverture médiatique et politique, avec les unes mensongères, les informations partielles ou truquées ont notamment montré que toute « la bonne volonté » dont Maduro pourrait faire preuve sur la scène internationale ne joue aucun rôle…
Mes honorables confrères ne font pas leur boulot. Ils ont décidé de dénoncer systématiquement la paille dans l’œil de Maduro tout en ignorant la poutre dans celui de l’opposition. Le journalisme est une profession extrêmement moutonnière. Bien peu de journalistes connaissent le Venezuela. Quand l’un d’entre eux, qui appartient presque systématiquement à la classe moyenne, arrive au Venezuela, il s’identifie avec elle. Elle se compose de gens « sympas », qui vivent dans des appartements décents, regardent les mêmes chaînes de télévision, voient les mêmes films, s’habillent comme nous… Vous allez les interviewer, ils vous offrent un whisky… Alors qu’une manifestation de chavistes, parfois ça paraît un peu brut de décoffrage. C’est vrai. Donc l’identification se fait tout naturellement. Et par-dessus le reste, aussi bien Chávez, Maduro, que les dirigeants chavistes, ne la jouent pas toujours dans la finesse ou la diplomatie…
Mais l’enjeu véritable, c’est ce qui se passe en ce moment au sein de l’Union européenne et de l’Organisation des États américains. Trump a décidé de sanctions économiques et l’Union européenne a fait de même le 13 novembre. L’OEA a investi le 13 octobre un Tribunal suprême de justice vénézuélien parallèle. On sera alors dans le début de la constitution d’un gouvernement en exil, susceptible d’appeler au secours, etc., avec tout ce que ça implique ensuite par rapport à la communauté internationale – le véritable enjeu.
Il ne faut pas oublier que sous le terme « communauté internationale », on entend l’UE et les États-Unis. Car le G77 + Chine, les pays non alignés, la Russie, l’Inde, la Chine, c’est-à-dire les trois quarts des pays présents à l’Assemblée générale des Nations-Unies, n’ont aucun problème avec le Venezuela ! En Amérique latine, le « groupe de Lima » (8)
est effectivement en train de mettre la pression sur le Venezuela, mais celui-ci peut encore compter sur la Bolivie, Cuba, le Nicaragua, trois îles de la Caraïbes… Quant à l’Équateur, où Moreno est en train de rompre avec le corréisme, la question va se poser.
Quel type de sanctions peut-on attendre ?
Filiale de PDVSA, l‘entreprise vénézuélienne de raffinage et de distribution Citgo, implantée aux États-Unis, n’a plus le droit de rapatrier ses bénéfices. Autre exemple : 300 000 doses d’insuline ont été bloquées à l’étranger parce que la City Bank refusait d’opérer la transaction… Ce qui permet ensuite le discours humanitaro-mensonger : « Du fait de l’incurie du pouvoir, il n’y a plus de médicaments au Venezuela », alors que le gouvernement a finalement passé des accords pour acheter des médicaments en Inde… Mais cela revient évidemment plus cher que de les faire venir de Californie !
De son côté, le Département du Trésor américain menace toute entité économique ou bancaire ayant des relations de travail avec le gouvernement vénézuélien d’être elle-même victime de sanctions. C’est un véritable étranglement économique qui se met en place, auquel l’Union européenne s’est jointe…
Face à cela, Caracas commence à imaginer d’autres stratégies : pour échapper aux sanctions américaines, elle se tourne aujourd’hui vers le yuan et le rouble comme nouveau système de paiement international.
Passer au yuan et au rouble, établir des accords avec la Russie, la Turquie… Cela ne change pas les problèmes internes au pays, dans la chaîne de production, qui offrent de nombreuses prises à la déstabilisation.
Pour le moment, non, et ça laisse ouverte la question : le pouvoir doit-il se radicaliser ou non ? Chacun a son avis là-dessus. S’il se radicalise, la « communauté internationale » lui tombe dessus et accentue la pression. S’il ne se radicalise pas, il prend des coups mortels et se fait critiquer sur sa gauche. C’est un choix cornélien.
Comment verriez-vous une « sortie de crise » ?
Rationnellement, ce serait l’élection présidentielle de 2018, quel qu’en soit le résultat. Encore faudrait-il que les États-Unis et l’Union européenne cessent leur ingérence et leur appui inconditionnel à l’opposition.
Un retour de la droite et de l’extrême droite au pouvoir ne serait pas une sortie de crise pour les chavistes : ceux qui ont montré leur soutien au gouvernement vont être sévèrement réprimés ; il y aura des privatisations, des licenciements, des coupes drastiques dans les budgets de l’éducation, de la santé, du logement…
L’hypothèse que, dans le cadre d’élections démocratiques, le chavisme perde serait lourde de conséquences et de signification, mais l’histoire ne s’arrêterait pas là. Ce serait infiniment moins grave que si, dans un contexte de violence, l’opposition parvenait à renverser Maduro. D’un côté on aurait : « Une révolte de la population a renversé le chavisme » ; de l’autre : « Démocratiquement, le chavisme a perdu l’élection et a accepté la défaite ». Cela ne l’empêchera pas, après avoir analysé ses erreurs et ses faiblesses, de revenir ultérieurement.
D’ailleurs, compte tenu de l’absence de programme et de l’extrême division de la droite, rien ne permet de dire que le chavisme ne gagnera pas la présidentielle de 2018. La MUD a semé un tel chaos et s’est montré tellement incohérente qu’elle a perdu beaucoup de ses sympathisants.
Les fameux « flux et reflux » appliqués à la révolution bolivarienne ?
On parle souvent de cycle, mais le vice-président bolivien Álvaro García Linera évoque une vague, qui se retire et puis revient. C’est un peu ça. Sauf régime autoritaire, un courant politique peut difficilement rester en place pendant cinquante ans. Il y a une usure du pouvoir. La révolution bolivarienne a dix-huit ans… Même pour la base, aussi volontariste soit-elle, il est difficile d’être révolutionnaire 24 heures sur 24 pendant aussi longtemps…
____________________
1. La classe moyenne vénézuélienne représente environ 15 % de la population.
2. Pour Emmanuel Macron, le régime du Venezuela est « une dictature »
3. Oil reserves
4. #EnVIVO @MariaCorinaYA: Aceptaremos una negociación verdadera solo para negociar la salida de Maduro del poder.
5. Contrôle des prix des aliments, hausse du salaire, impôt sur les grandes fortunes et affranchissement du dollar : Maduro poursuit l’offensive contre la guerre économique.
6. Pour plus de détails, voir : La guerre économique pour les nuls (et les journalistes), Maurice Lemoine, ainsi que Dólar Today distorsiona economía en Venezuela, confirma CEPAL (en espagnol).
7. Contrôle des prix des aliments, hausse du salaire, impôt sur les grandes fortunes et affranchissement du dollar : Maduro poursuit l’offensive contre la guerre économique.
8. Le groupe de Lima rassemble l’Argentine, le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, le Guatemala, la Guyane, le Honduras, la Jamaïque, le Mexique, le Panama, le Paraguay, le Pérou , Sainte-Lucie et l’opposition vénézuélienne . Le Groupe a été fondé le 8 août 2017. NDLR.



























 De dépit, Pasquale Paoli soulève alors à nouveau l'île contre Paris. Le jeune lieutenant Napoléon Bonaparte, tiraillé entre ses sympathies jacobines et ses racines corses, est un moment tenté de le suivre.
De dépit, Pasquale Paoli soulève alors à nouveau l'île contre Paris. Le jeune lieutenant Napoléon Bonaparte, tiraillé entre ses sympathies jacobines et ses racines corses, est un moment tenté de le suivre. 
 Sampiero serait né le 23 mai 1498 à Bastelica, en Corse du sud. Engagé très jeune dans le métier des armes, il se rend en Italie, où les cités n'en finissent pas de se faire la guerre.
Sampiero serait né le 23 mai 1498 à Bastelica, en Corse du sud. Engagé très jeune dans le métier des armes, il se rend en Italie, où les cités n'en finissent pas de se faire la guerre.  Les guerres d'Italie allant sur leur fin, Sampiero Corso commence à regarder du côté de son île, alors sous le joug de la République de Gênes, alliée de Charles Quint et donc hostile à la France.
Les guerres d'Italie allant sur leur fin, Sampiero Corso commence à regarder du côté de son île, alors sous le joug de la République de Gênes, alliée de Charles Quint et donc hostile à la France. 
 Le duc de Choiseul, qui dirige les affaires du royaume, est à l'origine de cette fructueuse transaction.
Le duc de Choiseul, qui dirige les affaires du royaume, est à l'origine de cette fructueuse transaction. 
 La veille, des militants de l'ARC (Action de la Renaissance de la Corse), un groupuscule dirigé par le médecin Edmond Simeoni, ont occupé une cave viticole de la plaine d'Aléria, sur la côte orientale de l'île.
La veille, des militants de l'ARC (Action de la Renaissance de la Corse), un groupuscule dirigé par le médecin Edmond Simeoni, ont occupé une cave viticole de la plaine d'Aléria, sur la côte orientale de l'île. 
 Une île aussi tourmentée que belle
Une île aussi tourmentée que belle